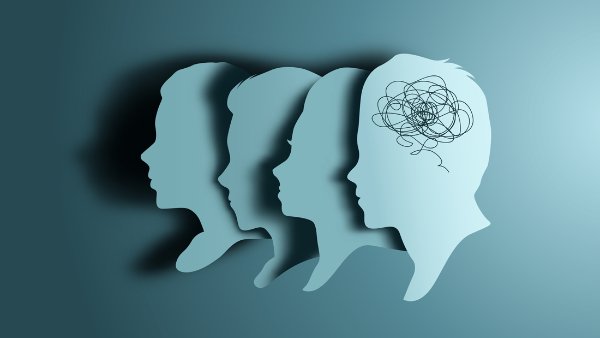Dans le cadre de litiges à la suite d’une fin d’emploi, les tribunaux peuvent être appelés à décider de la validité d’une transaction-quittance intervenue entre une personne salariée et un employeur. Cet aspect est important dans la mesure où la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée[1]. Dans les affaires Sbai c. Panthera Dentaire inc.[2] (« Sbai ») et Beaulieu c. LPA Médical inc.[3] (« Beaulieu »), l’article 2092 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») a justifié l’annulation d’une transaction-quittance.
L’affaire Sbai
La Cour supérieure est saisie d’une réclamation d’un salarié à l’égard de son employeur, visant l’annulation de son contrat de fin d’emploi, de la clause de non-concurrence contenue à son contrat d’emploi, la fixation d’un délai-congé et l’octroi de dommages moraux à la suite de son congédiement considéré comme abusif. Le Tribunal doit notamment décider de la validité de la transaction signée par le salarié. Il conclut qu’elle contrevient à l’art. 2092 du C.c.Q. et est frappée de nullité. Ainsi, elle ne peut être opposable au salarié et est réputée n’avoir jamais existé.
Les faits
Lors du recrutement, l’employeur offre au salarié un emploi à titre de « Directeur – Division sommeil ». Parmi les conditions d’embauche, le salarié doit notamment déménager à Québec avec sa famille. Après trois mois de travail, l’employeur met fin à la relation d’emploi au motif que « ça ne fit pas ». Sous le coup de l’émotion, le salarié signe une entente de départ, et l’employeur s’engage à lui verser en contrepartie un délai-congé correspondant à l’équivalent d’un mois de salaire.
Les motifs
Le Tribunal souligne que l’entente de départ est une transaction intervenue entre les parties afin de régler un différend et que, pour disposer de sa validité, il doit se référer aux motifs de nullité applicables à tout contrat, comme l’édicte l’art. 1399 du C.c.Q. L’employeur invoque l’autorité de la chose jugée et s’en remet à la clause de quittance complète et finale incluse dans la transaction qui se lit comme suit :
« J’ai lu le présent document et je comprends qu’il renferme une renonciation totale et définitive à toutes les réclamations que j’ai ou que je pourrais avoir à l’encontre des bénéficiaires de la présente renonciation. Je comprends que je décharge Panthera Dental de toutes actions, causes d’action, poursuites et plaintes découlant de mon embauche, de mon emploi ou de la cessation de mon emploi. Je signe le présent document de mon plein gré. »
[Nos soulignements]
Dans son analyse, le Tribunal rappelle que l’art. 2092 du C.c.Q. est d’ordre public et qu’il doit recevoir une interprétation large et libérale. Il prend en compte l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve le salarié lors de son congédiement, ainsi que son état de choc, faisant en sorte qu’il n’a pu signer la quittance en toute connaissance de cause. Le Tribunal mentionne ce qui suit :
« [95] Or, l’article 2092 C.c.Q. vient tempérer l’élan des employeurs qui seraient tentés d’empêcher toute contestation lorsqu’il s’agit d’une transaction relative au lien d’emploi, ou d’empêcher l’employé d’obtenir réparation dans le cas où le délai-congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive :
2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. »
[Nos soulignements]
Le Tribunal cite notamment le jugement rendu par la Cour du Québec dans l’affaire Beaulieu.
L’affaire Beaulieu
La Cour du Québec est saisie d’une réclamation d’une somme de 35 000 $ d’une salariée à l’égard de son employeur, à la suite de son congédiement. Le Tribunal doit notamment décider de la validité de la transaction-quittance, signée par la salariée. Il conclut que le contrat de transaction est frappé de nullité et n’est pas opposable à la salariée.
Les faits
La salariée est embauchée au poste de dessinatrice industrielle. Elle occupe par la suite la fonction de responsable de la mise en production pour la division Recherche et Développement de l’entreprise.
À la suite d’une période d’absence en raison d’une maladie, la salariée se présente au travail après avoir obtenu l’approbation de son médecin. Elle constate que son ordinateur ne reconnaît plus son code d’employée, qu’elle n’a plus l’usage de son bureau et que ses effets personnels se trouvent dans un tiroir. Son supérieur la rencontre et lui remet un document intitulé « Transaction, reçu et quittance ». Bouleversée, la salariée se résigne à signer ce document.
Les motifs
Le Tribunal mentionne que l’article 2092 du C.c.Q. apporte un tempérament important à la liberté contractuelle des parties au moment de résilier un contrat de travail. Il ajoute ce qui suit :
« [61] Cet article renferme une “règle impérative” 16, “une disposition de protection d’ordre public” 17 qui doit “recevoir une interprétation large”.18
[62] Elle “vise manifestement à accorder une protection aux salariés” 19 du fait “que le salarié est dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu’il est menacé de congédiement”.20
[63] Pour tout dire, la personne salariée se trouve alors “dans une situation d’infériorité en matière de négociations” 21 :
Le moment où il y a rupture de la relation entre l’employeur et l’employé est celui où l’employé est le plus vulnérable et a donc le plus besoin de protection.22
[64] Cette “vulnérabilité du salarié par rapport à l’employeur” 23 constitue le fondement même de l’article 2092 C.c.Q., lequel tend à “protéger le travailleur vulnérable et à rétablir l’équité contractuelle” .24 »
[Nos soulignements]
Le Tribunal conclut que la salariée n’a pas donné un consentement libre et éclairé au moment d’apposer sa signature sur la transaction. Compte tenu du fait que la salariée était fragile et vulnérable psychologiquement lors de la signature de la transaction, le Tribunal considère qu’elle n’était pas en mesure de comprendre toute la mesure de la portée juridique du document. Dans ce contexte, la renonciation à ses recours contre l’employeur n’a pas été faite en toute connaissance de cause.
Conclusion et commentaires concernant les affaires Sbai et Beaulieu
Les affaires Sbai et Beaulieu font ressortir des enseignements importants concernant l’article 2092 du C.c.Q. Cette disposition est d’ordre public et vise à rétablir l’équité contractuelle. En effet, comme mentionné dans sa disposition préliminaire, le C.c.Q. constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Les jugements rendus dans ces deux affaires démontrent l’importance de considérer l’ensemble des circonstances afin de déterminer si la personne salariée a donné un consentement libre et éclairé lors de la signature d’une transaction-quittance. Ainsi, afin de décider de la validité d’une transaction-quittance signée au moment de la fin d’emploi, l’état de vulnérabilité de la personne salariée pourra notamment être pris en considération. Les jugements rendus dans ces deux affaires illustrent que, lorsque le délai-congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive, le contrat de transaction peut être frappé de nullité et être déclaré inopposable à la personne salariée. En revanche, permettre un temps de réflexion à la personne salariée et lui laisser l’occasion de consulter un conseiller juridique, si elle le souhaite, pourrait être de bons conseils.
| 1 | Art. 2633 du C.c.Q. |
| 2 | 2022 QCCS 1609. |
| 3 | 2018 QCCQ 2594. |
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.