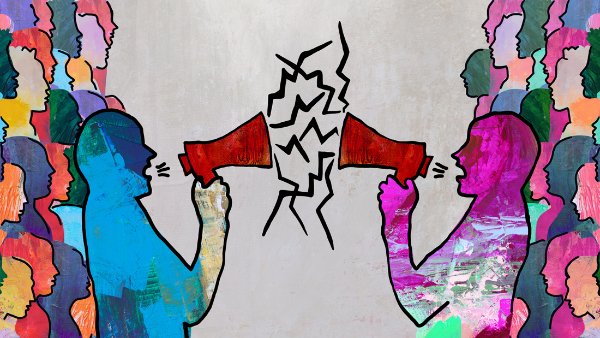À la suite d’une enquête en harcèlement, la mise en place des recommandations est un processus qui doit se faire avec diligence et doigté. Les organisations négligent souvent cette étape, laquelle est essentielle pour recréer un climat de travail sain.
Les prochains paragraphes offrent des conseils concernant les étapes à suivre afin de mettre en place les bonnes actions après l’enquête aux responsables de la gestion des ressources humaines ainsi qu’aux personnes désignées pour traiter les plaintes.
Que la plainte soit fondée ou non, les recommandations sont tout aussi importantes. Elles misent sur la résolution de la situation problématique ou le développement de comportements positifs afin de rétablir un climat sain. Les compétences de l’enquêteur en font un professionnel dont l’avis expert est pertinent.
Les recommandations préventives et curatives
Les recommandations de l’enquêteur sont généralement de deux types, soit préventives ou curatives. Les premières visent à informer et à sensibiliser les employés sur le harcèlement en milieu de travail. Les recommandations curatives sont orientées sur la mise en place d’outils ou un plan d’action pour les personnes en cause dans la plainte en harcèlement.
Pour les organisations sous législations provinciales au Québec, les recommandations ne sont pas toutes obligatoires, mais l’employeur a l’obligation morale et administrative de les considérer sérieusement et d’agir en conséquence. Concernant les organisations sous juridiction fédérale, selon l’article30 du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, l’employeur doit mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport d’enquête, sauf s’il détermine qu’une recommandation ne peut être mise en œuvre pour des raisons valables. Dans ce cas, l’employeur doit justifier par écrit la raison pour laquelle une recommandation n’est pas appliquée et doit proposer une mesure alternative. Si, au palier provincial, le mandant ne souhaite pas recevoir de recommandations, les enquêteurs certifiés en harcèlement (ECH) doivent l’inscrire au mandat.
Les éléments prescrits par la loi
Voici les obligations législatives pour l’ensemble des organisations, peu importe le nombre d’employés :
| Élément obligatoire | Québec – Loi 42 | Fédéral – Règlement |
|---|---|---|
| Politique, traitement des plaintes | Mettre en place une politique | Mettre en place une politique élaborée avec les comités Santé Sécurité au Travail (SST) |
| Évaluation des risques | Mener une analyse de risques psychosociaux, mettre en œuvre des mesures correctives, le cas échéant | Mener une analyse d’évaluation des risques incluant les facteurs internes et externes |
| Processus de traitement des plaintes | Mettre en place un processus clair et confidentiel, incluant la protection contre les représailles | Mettre en place un processus incluant des étapes précises : conciliation, enquête, mise en œuvre |
| Formation sur la civilité et le harcèlement |
Formation obligatoire pour les personnes désignées Sensibiliser les gestionnaires à leur rôle en prévention, détection et intervention Informer les employés sur les comportements inacceptables, les recours et les mécanismes de signalement Intégrer la formation dans le programme de prévention ou le plan d’action SST |
Offrir une formation obligatoire pour tous les employés et gestionnaires |
Délai lié à la mise en place des recommandations de l’enquêteur
Depuis le 27 septembre 2024, les employeurs sous juridiction provinciale au Québec doivent mettre à jour leur politique de prévention, former les personnes désignées pour recevoir et traiter les plaintes ainsi qu’intégrer les nouvelles exigences dans leur programme de prévention. Le 6 octobre 2025 est la date limite pour que tous les employeurs aient intégré la politique complète dans leur programme de prévention ou leur plan d’action officiel en santé et sécurité du travail. Pour les organisations sous réglementation fédérale, le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail prévoit un délai maximal d’un an pour conclure l’ensemble du processus de règlement d’un incident, y compris la mise en œuvre des recommandations formulées par l’enquêteur. Le délai d’un an commence à partir du jour où l’employeur est informé de l’incident.
Étapes importantes
Si les étapes décrites ci-dessous sont menées avec doigté, on minimise le risque de tensions supplémentaires et on prévient donc bien souvent les poursuites légales.
- Impliquer judicieusement les gestionnaires des parties après l’enquête
- Lorsque les parties relèvent d’un supérieur hiérarchique, il est important que la personne désignée prenne le temps d’informer ce dernier verbalement qu’un processus de traitement de plainte a été complété et de le conscientiser aux recommandations. Cette démarche fera une grande différence dans la réussite du plan d’action afin de rétablir le climat.
- Les sujets abordés avec les supérieurs hiérarchiques sont, entre autres, le processus de résolution de conflit après l’enquête. Souvent, après l’enquête, on demande trop rapidement aux parties de travailler ensemble sans avoir rétabli la relation.
- Planifier une rencontre avec chacune des parties afin d’expliquer le résultat de l’enquête en harcèlement
Une enquête en harcèlement est un processus difficile émotivement autant pour le plaignant que pour la personne mise en cause. Le résultat de l’enquête est attendu avec anxiété. Il est primordial de planifier une rencontre en personne. Le fait de rencontrer les parties après la remise du rapport d’enquête est la première étape. Il est recommandé de la mettre en place juste avant d’implanter les recommandations de l’enquêteur.
Les personnes présentes lors de cette rencontre
Il est important que la personne désignée pour coordonner le traitement de la plainte chez l’employeur, par exemple un représentant en gestion des ressources humaines CRHA ou CRIA, facilite cette rencontre. Il n’y a pas de règle stricte qui dicte si l’enquêteur doit y être présent ou non. Toutefois, sa présence est préconisée. Le fait que la partie visée puisse lui poser des questions est bénéfique. Cette démarche démontre la neutralité du processus, et sa présence renforce la crédibilité et la transparence de l’enquête. Sans compter qu’elle facilite la gestion des émotions et prépare la partie rencontrée aux prochaines étapes (par ex. : le processus de résolution de conflits entre le plaignant et la personne mise en cause après l’enquête, le cas échéant). L’enquêteur et la personne désignée devront faire preuve de tact et de jugement afin de préserver les aspects confidentiels contenus dans le rapport d’enquête. Si la partie rencontrée est syndiquée et qu’elle a été accompagnée durant le processus d’enquête par un représentant syndical, par exemple, il est d’usage d’inviter l’accompagnateur, si la partie le désire, à cette rencontre. L’accompagnateur est toujours lié à son entente de confidentialité signée au début du processus d’enquête.
Durée estimée de cette rencontre
La rencontre devrait être assez longue pour expliquer les conclusions de l’enquête au plaignant ou à la personne mise en cause et répondre à ses questions. Elle ne devrait pas s’éterniser, ce qui laisserait trop de place à l’argumentation. À cette étape, le rapport a été déposé, et il n’est pas question de revenir sur le résultat de l’analyse. Une rencontre qui peut varier entre 30 minutes et une heure tout au plus est souvent suffisante à ce stade-ci.
Contenu de la rencontre
Le but de cette rencontre est d’expliquer la méthodologie utilisée, la démarche d’analyse et les critères pris en compte afin de déterminer si, selon la prépondérance de preuve, la plainte avait été jugée fondée. Afin de préserver la confidentialité, il est important de ne pas dévoiler les noms des témoins rencontrés. En fin de rencontre, il est important, afin de bien documenter le dossier, de remettre une courte lettre émise par le service des ressources humaines au plaignant et à la personne mise en cause faisant mention de la méthodologie utilisée et des résultats de l’enquête, entre autres.
Confidentialité
Après l’enquête, voici un sommaire de ce qui peut être partagé et avec qui, selon les bonnes pratiques et dans le respect des exigences légales au Québec et au Canada :
| Destinataire | Type d'information | Conditions |
|---|---|---|
| Plaignant | Résultat de l'enquête, recommandations le concernant | Rencontre individuelle en réitérant que la confidentialité est assurée, référence à l'entente de confidentialité signée au début du traitement de la plainte par l'enquêteur |
| Personne mise en cause | Résultat de l'enquête, recommandations le concernant | Rencontre individuelle en réitérant que la confidentialité est assurée, référence à l'entente de confidentialité signée au début du traitement de la plainte par l'enquêteur |
| Gestionnaire(s) des parties | Sommaire des recommandations le/les concernant ainsi que les membres de leurs équipes | Signature d'une entente de confidentialité recommandée |
| Comité SST ou RH | Recommandations générales | Identifier les parties et les témoins, si nécessaire et sous toute réserve. Confidentialité requise |
| Témoins | Rien sur les conclusions | Seulement les éléments pour lesquels ils ont été interrogés, sur demande |
Pour conclure, la personne désignée joue un rôle stratégique dans la mise en place des recommandations sélectionnées, qu’elles soient préventives ou curatives. Cette démarche requiert les connaissances adéquates de la législation en vigueur, un sens du discernement aiguisé et de la proactivité.
Sources :
- Guide d’encadrement : pratique professionnelle en matière d’enquête à la suite d’une plainte pour harcèlement au travail: Pratique professionnelle en matière d'enquête à la suite d'une plainte pour harcèlement au travail
- Droits et obligations en matière de harcèlement
- Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
- Liste des obligations de l’employeur et du destinataire désigné pour prévenir le harcèlement et la violence sur le lieu de travail
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.