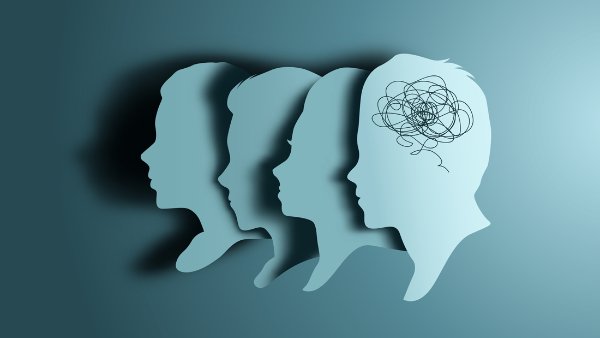La récente révélation publique d’une relation extraconjugale entre un PDG et une vice-présidente des ressources humaines assistant à un concert de Coldplay a suscité de vives réactions. Cet événement a relancé les débats sur les limites entre vie privée et sphère professionnelle. Une question délicate, mais essentielle se pose dans ce contexte : dans quelle mesure un employeur peut-il intervenir lorsqu’une relation amoureuse se développe entre des membres de son personnel?
Ce cas médiatisé soulève plusieurs enjeux : le risque de conflit d’intérêts, les répercussions sur le climat de travail, le respect de la vie privée et l’importance d’adopter une politique claire sur les relations amoureuses en milieu professionnel.
Cadre juridique
Les relations amoureuses en milieu de travail mettent en cause la nécessaire recherche d’un équilibre entre les obligations et les droits respectifs de l’employeur et de l’employé.
D’une part, l’employé a droit au respect de sa vie privée[1]. Il est également tenu à une obligation de loyauté envers son employeur et doit faire preuve de diligence dans l’exécution de son travail[2]. Cet engagement requiert notamment d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts, ou d’apparence d’un tel conflit, ou encore de participer à toute situation susceptible de nuire au climat de travail.
D’autre part, l’employeur doit assurer un milieu de travail sain et exempt de harcèlement. Il doit également mettre en place diverses mesures visant à protéger ses intérêts et son image.
En matière de relations amoureuses au travail, l’employeur sera en droit d’intervenir lorsque la relation est susceptible de placer l’employé en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, ou lorsqu’elle compromet le climat de travail[3]. Le test sera celui du lien suffisant entre la situation personnelle et le travail.
Conflit d’intérêts
Les tribunaux ont été saisis à maintes reprises de situations où des relations amoureuses au travail ont donné lieu à des conflits d’intérêts pouvant justifier l’intervention de l’employeur.
Dans l’affaire Gouin et Société des casinos du Québec inc.[4], un cadre entretenait une relation amoureuse avec une croupière. Cette situation avait mené le cadre à privilégier ses intérêts personnels ainsi que ceux de sa conjointe, au détriment de leurs obligations professionnelles respectives. En effet, à la demande de celle-ci, il avait consulté l’horaire de son ex-mari, également croupier. Elle cherchait à obtenir des renseignements personnels le concernant. La relation intime que le cadre entretenait avec cette employée et l’utilisation des informations confidentielles auxquelles il avait accès dans l’exercice de ses fonctions soulevaient un conflit d’intérêts qui s’était dans les faits matérialisé. Dans ces circonstances, le tribunal a conclu au bien-fondé du congédiement du cadre, soulignant les enjeux relatifs à la protection des renseignements personnels[5].
Dans l’affaire Reichard v. Kuntz[6], le tribunal de l’Ontario a confirmé la validité du congédiement d’un directeur des achats qui entretenait une liaison amoureuse avec son adjointe. Cette relation était à l’origine de favoritisme, notamment une recommandation pour un transfert, des pauses déjeuner prolongées et une tolérance envers une infraction disciplinaire commise par cette dernière. Ce comportement était incompatible avec la conduite attendue d’un cadre.
Ces décisions illustrent des situations où les relations amoureuses entre collègues ont mené à des conflits d’intérêts réels justifiant l’intervention de l’employeur. Rappelons cependant un principe fondamental en matière de conflits d’intérêts, soit celui des apparences. Il n’est pas nécessaire qu’une personne fasse un geste où elle privilégie ses intérêts pour qu’elle se trouve en conflit d’intérêts. Il faut plutôt se demander s’il existe une situation pouvant raisonnablement faire craindre que l’employé privilégie ses intérêts personnels à ceux de l’employeur :
« Il n’est pas nécessaire de prouver que l’employeur a subi un préjudice réel. Le préjudice virtuel suffit. (…) Il n’y a aucune preuve que le défendeur était en quelque sorte lésé par les conflits d’intérêts potentiels. Néanmoins, dans des situations de conflit d’intérêts, la règle de l’épouse de César s’applique. Il ne doit pas seulement être pur, il doit être perçu comme pur. Il n’importe pas que le comportement de l’employé visait à protéger seulement son propre intérêt et ne cherchait pas à nuire à celui de son employeur. »[7]
En somme, lorsqu’il existe une situation pouvant mettre en cause les intérêts personnels d’un employé et ceux de son employeur, y compris une relation amoureuse, la prudence sera de mise. Des relations amoureuses entre collègues seront parfois susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts. Pensons par exemple à la situation où un conjoint supervise ou évalue l’autre dans le cadre du travail ou encore où l’un des conjoints est un haut dirigeant susceptible d’influencer le parcours professionnel de l’autre. Dans de tels cas, il sera sage de divulguer la situation à l’employeur sans trop tarder afin qu’une discussion soit engagée sur les moyens qui peuvent être mis en place afin de gérer la situation, le cas échéant.
Impact néfaste sur le milieu de travail
L’employeur pourra également être en droit d’intervenir lorsque la relation amoureuse entre collègues nuit au bon fonctionnement de l’environnement de travail ou compromet le climat organisationnel.
L’affaire Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal[8] illustre bien les répercussions qu’une relation amoureuse entre collègues peut avoir sur le milieu de travail. Deux professeurs travaillant au sein de la même université ont entretenu une relation pendant près de 20 ans. À la suite de leur rupture, la femme a porté plainte pour agression sexuelle et en a parlé ouvertement à ses collègues au moyen de la messagerie électronique de son employeur. Son ex-conjoint, estimant que ces dénonciations portaient atteinte à sa réputation et à sa dignité, a déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Dans cette affaire, la diffusion publique d’accusations jugées non fondées a exposé des conflits personnels dans un cadre professionnel, contribuant ainsi à détériorer le climat de travail. Le tribunal a conclu que la plainte de la professeure était non fondée et que son congédiement était justifié.
Cette affaire met également en lumière l’obligation de l’employeur d’agir afin de prévenir et de faire cesser toute situation pouvant constituer du harcèlement psychologique. Lorsqu’un employé subit de la violence ou voit sa santé physique ou mentale menacée, il incombe à l’employeur d’intervenir pour assurer sa sécurité. Cette responsabilité passe notamment par la mise en place d’une politique claire de prévention et des mesures concrètes pour prendre en charge rapidement les situations problématiques. Ainsi, lorsqu’une relation connue entre collègues prend fin, il est important que l’employeur demeure attentif aux répercussions possibles d’une telle rupture sur le milieu de travail. Sans s’immiscer dans la vie privée des personnes concernées, il doit rester vigilant aux signes potentiels de harcèlement psychologique.
Enfin, il importe de rappeler que l’employeur assume maintenant certaines responsabilités visant à protéger un employé exposé à une situation de violence conjugale : l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence[9].
Une politique à l’égard des relations amoureuses entre collègues?
Interdire purement et simplement les relations amoureuses entre collègues pourrait être incompatible avec la Charte des droits et libertés de la personne, l’employeur s’immisçant de façon trop invasive dans une sphère de la vie privée des employés. L’employeur peut cependant encadrer les relations amoureuses entre collègues sous l’angle d’une politique interne qui vise à prévenir les conflits d’intérêts et à maintenir un environnement sain. Des règles claires et prédéfinies permettront de prévenir les situations malencontreuses où des employés bien intentionnés se retrouvent au cœur d’une enquête disciplinaire pour conflit d’intérêts, tout en assurant le maintien d’un climat de travail sain et exempt de harcèlement ou de traitements inéquitables ou injustes.
Une telle politique devrait prévoir les circonstances où une relation amoureuse avec un autre collègue doit être divulguée à l’employeur. Ces circonstances devraient inclure les relations amoureuses susceptibles de soulever un conflit d’intérêts réel ou apparent, comme l’existence d’un rapport hiérarchique direct ou encore lorsque l’un des conjoints occupe une fonction où il est susceptible d’influencer le parcours professionnel de l’autre ou de lui procurer des avantages.
La politique devrait également identifier le représentant de l’employeur responsable de recevoir les divulgations et fournir des garanties quant au traitement confidentiel des informations. Enfin, la politique peut identifier les mesures pouvant être prises afin d’encadrer une relation amoureuse entre collègues ainsi que les conséquences en cas de non-divulgation d’une relation visée.
Conclusion
En conclusion, si l’employeur ne peut interdire totalement les relations amoureuses entre collègues, il sera bien fondé à intervenir ou pourra établir des balises lorsque la relation amoureuse a une incidence directe sur le milieu de travail ou soulève un conflit d’intérêt réel ou apparent. L’expérience révèle que les collègues tourtereaux tarderont souvent à divulguer la situation à leur employeur, sans doute par méconnaissance des règles applicables en matière de conflit d’intérêts. Or, même les cœurs les plus purs pourront générer des perceptions d’iniquités dans le milieu de travail, particulièrement lorsque l’on tente pendant trop longtemps de cacher une relation souvent connue de plusieurs collègues. L’adoption d’une politique claire et objective demeure la meilleure façon d’encadrer ces situations, et surtout, de communiquer aux employés leurs devoirs et responsabilités en matière d’histoires de cœur au travail.
| 1 | Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C -12, art. 5 et Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 3 et 35. |
| 2 | Code civil du Québec, ibid art. 2088. |
| 3 | Alam c Canada Workday, 2024 QCTAT 2318, par. 127 et 128. |
| 4 | Gouin et Société des casinos du Québec inc. 2019 QCTAT 2886. |
| 5 | Ibid, par 50. |
| 6 | Reichard v. Kuntz, 2011 ONSC 7460. |
| 7 | Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Boisvert, 1986 CanLII 6862 (CAF), [1986] 2 CF 431. Voir également : Conseil des Innus de Pessamit c. Riverin, 2017 CF 934 (CanLII). |
| 8 | Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c Université de Montréal 2022 CanLII 68102 (QC SAT). |
| 9 | Loi sur la santé et la sécurité au travail, RLRQ c S-21, art. 51. Pour plus d’informations concernant les responsabilités de l’employeur en matière de violence conjugale : Violence conjugale ou familiale | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST. |
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.