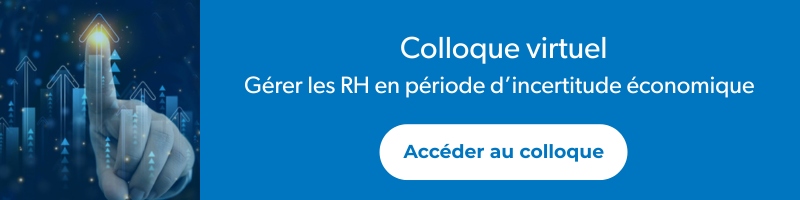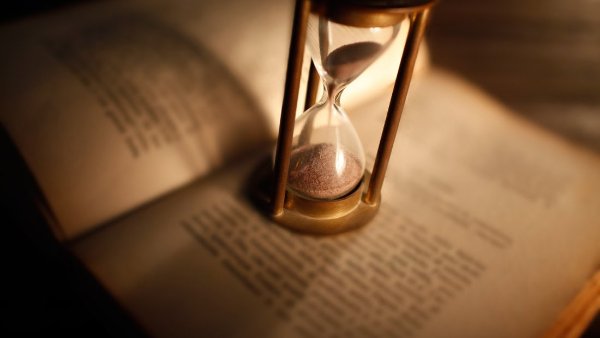Transformer nos habitudes de réunion pour retrouver l’efficacité
Dans les bureaux modernes et derrière les écrans de visioconférence, un mal silencieux ronge la productivité des entreprises : la réunionite. Ce phénomène, déjà problématique avant la pandémie, a explosé avec l’essor du télétravail. On est devenu une société de réunionistes. Il n’y a presque plus personne qui, pendant la journée de travail, ne passe pas d’une réunion à l’autre. Cette multiplication des rencontres virtuelles et présentielles paralyse l’efficacité organisationnelle et épuise les équipes. Pourtant, des solutions concrètes existent pour retrouver un équilibre productif.
Le coût caché du multitâche en réunion
Les chiffres sont révélateurs de l’ampleur du problème : 31 % des participantes et participants souhaitent décliner des réunions auxquelles ils assistent par obligation sociale ou hiérarchique. Plus alarmant encore, 70 % pratiquent le multitâche pendant ces rencontres, consultant leurs courriels ou travaillant sur d’autres dossiers tout en feignant l’attention.
Toutes les études de neurosciences ont démontré que le cerveau humain ne fait pas du multitâche. Et quand il fait du multitâche, il ne produit pas de la qualité. Cette réalité transforme les réunions en double perte : ni l’écoute active ni le travail parallèle ne sont efficaces.
Par ailleurs, les neurosciences confirment cette observation : le cerveau ne peut traiter qu’une tâche cognitive complexe à la fois. Le prétendu multitâche consiste en réalité en un va-et-vient rapide entre les tâches, générant de la fatigue cognitive entraînant des erreurs. Résultat : des décisions de moindre qualité en réunion et des livrables bâclés en parallèle.
L’incidence économique de cette inefficacité se chiffre concrètement. Les études ont démontré que si on limitait la réunionite, on pourrait économiser jusqu’à 25 000 dollars annuellement par employé en perte de productivité.
Les principes d’une réunion efficace
Pour combattre ce fléau, il existe plusieurs principes basés sur la science cognitive. Premier impératif : respecter les rythmes biologiques. Le cerveau fonctionne bien le matin. Il fonctionne bien au calme. N’organisez pas de réunions en début de semaine ni en fin de semaine. Faites-les en milieu de semaine et surtout, en milieu de journée.
Cette recommandation s’appuie sur les cycles naturels d’attention. Le lundi, les équipes se remettent dans le bain professionnel après la fin de semaine. Le vendredi, l’attention dérive vers les projets personnels. Les mardis, mercredis et jeudis offrent les créneaux optimaux pour la concentration collective.
La composition des réunions obéit également à des règles précises. Assurez-vous qu’il n’y ait jamais plus de sept personnes dans une réunion. Pourquoi sept personnes? Les neurosciences ont démontré que la huitième commence à diminuer la productivité de l’équipe. Au-delà de ce seuil, les dynamiques de groupe se dégradent : certaines personnes se désengagent, d’autres monopolisent la parole, alors la prise de décision devient laborieuse.
Pour les visioconférences, la durée optimale se situe entre 20 et 25 minutes maximum. Cette contrainte temporelle force la préparation et maintient l’attention des participantes et participants. Chaque réunion doit disposer d’un ordre du jour précis, communiqué à l’avance.
Repenser le présentiel et le distanciel
L’organisation du travail en mode hybride (présentiel et distanciel) nécessite une réflexion sur l’usage optimal de chaque mode. Quand on est au bureau, c’est pour travailler ensemble. Quand on fait de la production et qu’on doit travailler dans l’asynchrone, là, on peut rester chez nous.
Cette distinction fondamentale remet en question de nombreuses pratiques actuelles. Ce qui est absurde, c’est de se retrouver en asynchrone sur le lieu de travail, c’est-à-dire que je me retrouve au lieu de travail, mais je tape sur mon ordinateur et je travaille dans ma bulle. Organiser des réunions collaboratives depuis le domicile perd une partie de sa valeur ajoutée.
Le présentiel devrait privilégier les séances de remue-méninges, les prises de décisions collectives, les formations interactives et les moments de cohésion d’équipe. Le distanciel convient mieux aux tâches de production individuelle, à la rédaction, à l’analyse de données ou aux entretiens individuels.
Cette approche demande de repenser l’aménagement des espaces de travail. Les bureaux doivent favoriser la collaboration avec des salles de réunion modulables, des espaces de créativité et des zones de rencontre informelle, plutôt que de simples postes individuels.
Préserver l’espace de production
Un principe crucial guide cette transformation : assurez-vous que la personne, quand elle vient en réunion, a réussi à faire son travail. Cette recommandation bouleverse l’organisation traditionnelle qui enchaîne les réunions dès le matin.
Commencer la journée par des rencontres empêche l’accomplissement de tâches productives. Si vous commencez vos réunions tôt le matin, une personne pourrait ne pas avoir produit ce qu’elle devait produire. Pendant toutes les réunions, elle va penser à tout le travail qu’elle aurait dû faire au lieu d’assister à cette réunion.
Cette situation génère un cercle vicieux : stress de l’inaccomplissement, attention partagée en réunion, rattrapage en soirée ou la fin de semaine. La qualité du travail et l’équilibre vie-travail se dégradent simultanément.
La solution consiste à bloquer des créneaux de production en début de journée, quand l’énergie cognitive est maximale. Les réunions s’inscrivent ensuite, quand les participantes et participants ont progressé sur leurs dossiers et peuvent donc s’investir pleinement dans les échanges collectifs.
Cultiver l’art du refus constructif
Une transformation culturelle accompagne ces changements techniques. Les organisations doivent légitimer le droit de décliner une réunion sans valeur ajoutée. Cette évolution demande du courage managérial et de la pédagogie.
Il y a des gens qui voudraient décliner une réunion, mais ils ne le font pas parce qu’ils n’osent pas dire qu’ils n’ont pas de valeur ajoutée dans la réunion. Cette réticence sociale maintient l’inefficacité collective.
Former les équipes à remettre utilement en question leur participation constitue un investissement rentable. Avant chaque réunion, trois questions simples s’imposent : quelle est ma contribution spécifique? Quelles décisions nécessitent ma présence? Comment puis-je être informé des conclusions sans assister à l’intégralité?
En conclusion, il faut opter pour une approche qui responsabilise chacun, tant les membres de la direction que les employées et employés sur l’usage du temps de travail, individuel ou collectif. L’organisation doit permettre un espace de discussion franc et ouvert. L’enjeu dépasse la simple optimisation du temps. Il s’agit de préserver l’énergie créative des équipes, de maintenir leur engagement et de leur permettre de produire un travail de qualité dans un environnement de plus en plus complexe.
Vous avez aimé l'article?
Sur un sujet connexe, Philippe nous a fait le plaisir de nous donner ses éclairages lors de sa conférence « Se transformer en conservant son ADN ». Une des 4 conférences de notre colloque « Gérer les RH en période d'incertitude économique ».
Ce colloque gratuit pour les personnes abonnées au Carrefour RH et pour les CRHA | CRIA est disponible dès maintenant.