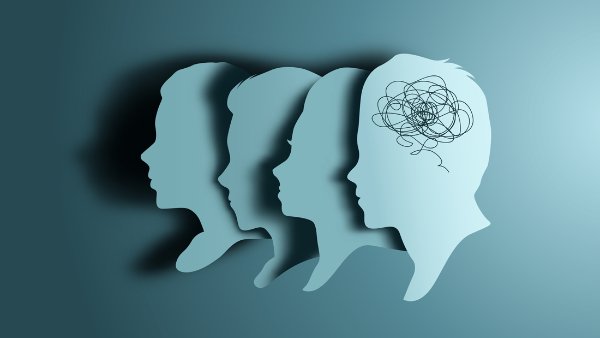Présenté par 
Question
Peut-on prétendre à une discrimination si la personne ne déclare pas son handicap, ne se considère pas comme une personne racisée ou appartenant à un autre groupe protégé, ou préfère ne pas répondre à cette question?
Réponse
Oui. L'existence d'une situation de discrimination ne dépend pas de sa divulgation par la personne concernée. Le devoir de tout employeur est de prévenir la discrimination au travail, et d'agir raisonnablement et diligemment lorsqu'une telle situation survient ou est susceptible de se produire. La clé réside dans l'information dont dispose l'employeur, qui lui permet (ou non) de constater la présence d'une situation discriminatoire sur le lieu de travail.
En ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, il peut certes exister des situations où le handicap de la personne est invisible, et où les indices sont insuffisants pour indiquer à l'employeur que cette personne est en situation de handicap. Dans un tel cas, l'employeur est exonéré de tout reproche, ce dernier n'ayant pu remédier à une situation de discrimination directe ou indirecte ou encore se décharger de son obligation d'accommodement raisonnable, car il ne savait réellement pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que la personne était en situation de handicap. Cela dit, l'employeur ne peut pas non plus faire preuve d'aveuglement volontaire lorsque des indices ou des informations lui permettent d'au minimum raisonnablement douter de la présence d'un handicap chez une personne à son emploi. Dans un tel cas, l'employeur qui sait ou devrait savoir qu'une personne est en situation de handicap, même si cette dernière ne lui en a pas parlé, il a tout de même l'obligation d'accommoder cette personne et de prévenir les situations discriminatoires à son égard[1].
Il en va de même pour les autres caractéristiques personnelles protégées, comme la race, l'identité ou l'expression de genre, etc. Le fait que la personne ne se considère pas comme membre de ces groupes protégés n'est pas pertinent. Dans la mesure où les faits démontrent la présence de discrimination fondée sur la race, l'identité ou l'expression de genre, l'employeur a le devoir d'agir, car cela engage sa responsabilité.
À cet égard, il convient de bien distinguer la discrimination du harcèlement discriminatoire. Pour conclure à la présence de harcèlement discriminatoire, l'effet négatif et durable sur la personne est une composante essentielle. Nécessairement, si la personne ne se considère pas comme faisant l'objet d'une discrimination fondée sur l'un des motifs prohibés, cet effet négatif durable risque d'être moindre, ce qui affaiblir les probabilités que l'on puisse conclure à du harcèlement. Or, cet élément est absent pour conclure à la présence de discrimination. Dès lors qu'un traitement différencié, fondé au moins partiellement sur un motif prohibé de discrimination et compromettant l'exercice ou la reconnaissance, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne est constaté, il y a discrimination. L’employeur doit alors agir, en accommodant le salarié, lorsqu’il est possible, ou en mettant fin à la pratique ou au comportement discriminatoire.
Toutefois, le déni de la personne qui refuse d'admettre qu'elle est en situation de handicap ou d'une autre caractéristique protégée pourra vraisemblablement avoir un effet sur l'étendue de l'obligation d'accommodement de l'employeur. Le processus d'accommodement étant collaboratif de nature, il est fort probable que l'employeur se décharge rapidement de son obligation d'accommodement dans la mesure où la personne refuse d'y participer.
Question
Qu'en est-il de l'incidence des limitations fonctionnelles d'une personne et de l'obligation d'accommodement de l'employeur quant au paiement d'heures supplémentaires ?
Réponse
Il est effectivement possible que certaines limitations d'une personne (TDA/H, toute autre difficulté d'apprentissage, limitations physiques dans le cadre d'emplois plus physiques ou manuels, etc.) impliquent qu'il lui soit difficile ou impossible d'accomplir les mêmes tâches que ses collègues, dans le même temps. Dans de tels cas, deux choix s'offrent à l'employeur[2] :
- Permettre à la personne d'effectuer des heures supplémentaires et de la rémunérer en conséquence, afin qu'elle puisse s'acquitter de l'ensemble de ses tâches. Cela dit, l'employeur conserve toujours le droit de vérifier la prestation de travail de cette personne afin d'éviter les abus, ou encore de refuser les heures supplémentaires lorsque cela n'est pas nécessaire ou injustifié ;
- Retirer à la personne certaines de ses tâches, ou remanier celles-ci, afin qu’elle puisse respecter ses horaires de travail habituels. Cette décision ne doit toutefois pas avoir pour effet de pénaliser la personne. Par exemple, si cela affecte ses évaluations de performance, ses augmentations salariales ou ses perspectives d’avancement, il s’agirait de discrimination indirecte.
Toutefois, si les limitations de la personne constituent une contrainte excessive pour l'employeur[3], par exemple en dénaturant le poste qu'elle occupe ou en entraînant un nombre significatif d'heures supplémentaires, l'employeur serait en droit de réévaluer la situation afin de déterminer s'il est en mesure de l'accommoder. Si ce n'est pas le cas, il doit envisager les mesures à prendre.
Avis
Les présentes réponses sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Ces informations ne peuvent pas se substituer aux conseils d’un professionnel ou d’une professionnelle du droit. Le Carrefour RH, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et l’auteur ou l’autrice de cette réponse déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation ou à l’interprétation qui pourrait être faite de ces informations, de même que pour toute décision ou toute action qui en découlerait. Nous vous recommandons de consulter un professionnel ou une professionnelle pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.
Vous avez une question?
Soumettez-nous votre cas en décrivant votre situation. Les expertes et experts juridiques sélectionneront les cas les plus représentatifs et formateurs pour y répondre dans la chronique. Tous les renseignements sont traités de façon confidentielle.
Envoyez vos questions dès maintenant à carrefourrh@ordrecrha.org.
Note importante
Ce service est offert exclusivement aux CRHA, CRIA et abonnés au Carrefour RH.
| 1 | Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau, section locale 2000 et Hydro-Québec, 2024 QCTA 232. |
| 2 | À noter que pour les employeurs évoluant dans des milieux syndiqués, comme l'octroi d'heures supplémentaires fait habituellement l'objet de dispositions dans la convention collective, une dérogation à celles-ci dans une perspective d'accommodement devra faire l'objet d'une discussion avec le syndicat. |
| 3 | Voir notamment Mascouche (Ville de) et Fraternité des policiers de Mascouche inc., D.T.E. 99T-622 (T.A.) (Requête en révision judiciaire rejetée, C.S., 1999-12-16). |
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.